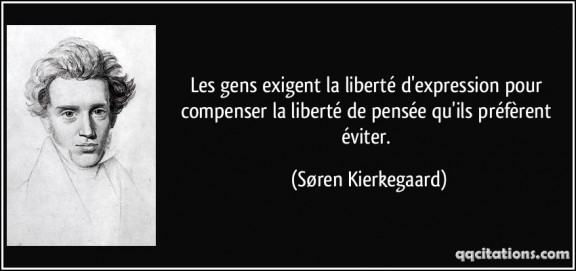Liberté d’expression. Liberté de pensée. Soren Kierkegaard (*).
(*) Philosophe danois (Copenhague 1813-Copenhague 1855).
Admirateur mais adversaire de Socrate, Søren Kierkegaard livre une œuvre qui relève autant de la philosophie spéculative que de la théologie savante et de la poésie lyrique. Placée sous le double signe du paradoxe et de l’exception, sa pensée inaugura au xixe s. un mode d’expression jusqu’alors inédit.
L’œuvre de Kierkegaard tire la quasi-totalité de sa substance de la vie même de l’auteur.
Écrivant pour s’édifier en édifiant ses contemporains, il ne médite sur l’existence qu’afin de corriger la sienne propre, mais sur ce paradoxe fondamental que le particularisme de ses problèmes intéresse par essence l’ensemble des hommes.
De son père Søren a hérité un sens religieux de la culpabilité. Il se sent né pour un combat perdu d’avance, où il ne lui reste qu’à « espérer contre toute espérance ». D’autant qu’au rapport angoissé avec un père austère et dévot succède la rupture avec celle qu’il aime, Regine Olsen. Il se sépare d’elle après un an de fiançailles, en 1841, le lendemain de sa soutenance de thèse sur le Concept d’ironie constamment rapporté à Socrate. Sa passion devient alors passion de l’écriture. Autour de la double hantise du père et de Regine disparue (elle se mariera en 1847) s’organise une production littéraire où se répondent les sermons et exercices théologiques et la critique du spéculatif, au nom de l’existence.
Enten-Eller (Ou bien… ou bien), signé Victor Eremita, inaugure, en 1843, la carrière de Kierkegaard et la vogue de ses pseudonymes. Crainte et tremblement, par Johannes de Silentio, paraît la même année, suivi desMiettes philosophiques, par Johannes Climacus (1844), et d’une méditation sur le péché : le Concept d’angoisse. Les fiançailles et la rupture sont le sujet des Étapes sur le chemin de la vie (1845). Post-scriptum définitif et non scientifique aux Miettes philosophiques (1846) analyse les relations entre la vérité et l’expérience vécue. Sur l’existence et le sens du péché paraît, en 1849, le Traité du désespoir. Kierkegaard n’a cessé entre-temps de composer des discours édifiants (la Pureté du cœur) et de prendre de plus en plus fermement position contre la hiérarchie ecclésiastique.
En 1849, sa démarche pour obtenir un poste dans l’Église danoise reste sans réponse. Il réagit alors par une œuvre polémique, l’École du christianisme (1850), où il dénonce le scandale d’un christianisme sans chrétiens. C’est l’affrontement avec les autorités religieuses et avec l’évêque Mynster. Isolé et déchaîné, Kierkegaard fonde en 1855 un journal satirique, l’Instant, dont il assure seul la parution et qu’il publiera jusqu’à épuisement complet de ses forces.
(Larousse.)