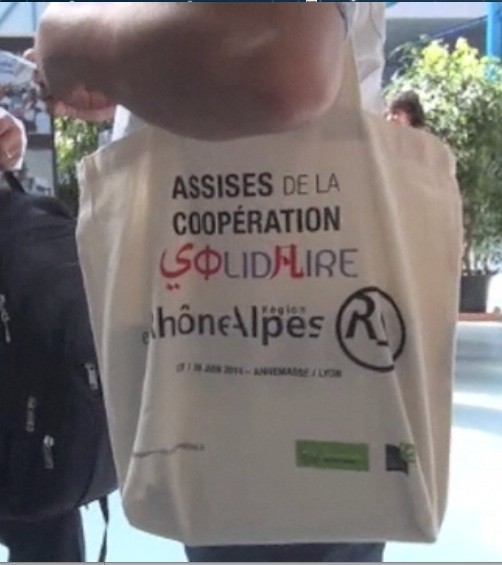Les 5èmes rencontres de la coopération solidaire repeintes aux couleurs de la participation citoyenne
Annemasse était, ce vendredi 27 juin la capitale de la coopération solidaire.
Martin Luther King, dont le nom est inscrit au fronton de la salle, a été maintes fois cité aux côtés de Nelson Mandela et de Pablo Neruda comme les symboles de la lutte pour la dignité des peuples.
Cette journée, à l’initiative de Véronique Moreira, déléguée à la coopération solidaire au sein du Conseil Régional Rhône Alpes, a rassemblé près de 300 délégués venus de tous les continents, accueillis par Christian Dupessey, Maire d’Annemasse et Conseiller régional.
Nicolas Niemtchinow, ambassadeur de France auprès des Nations-Unies, marquait la présence de l’État.
Lors des discours d’introduction, toutes et tous ont souligné le rôle de la région, et en particulier sur le territoire celui de la ville d’Annemasse, proche des organisations internationales sur Genève et ayant pour objectifs de construire des solidarités, du lien social, de coordonner des actions au sein de la Cité Internationale (CIS) pour développer de l’intelligence collective. Cette structure est un appui à la politique culturelle, aide à relever des défis sociaux.(N’oublions pas que l’agglomération d’Annemasse comprend près de 102 nationalités.). Cela constitue une force de propositions avec tout un réseau associatif et d’ONG.
2014 : Année Internationale de l’agriculture familiale.
C’est une lutte quotidienne pour vaincre la pauvreté, où le rôle des femmes est fondamental.
Véronique Moreira souligne l’engagement des Rhône-alpins et ceci depuis longtemps sur ces questions. Face à la mondialisation, il n’y a pas d’autre alternative que de créer de la solidarités sur les territoires où sévit la faim, comme au Sahel.
Nicolas Niemtchinow rappelle que la préoccupation du gouvernement français est de promouvoir l’action des collectivités territoriales pour une coopération décentralisée. Il rappelle que 5000 collectivités sont engagées dans 145 pays, sur 13000 projets.
L’accès à l’énergie et à l’eau est une préoccupation. Ce qui se réalise doit se faire avec des critères de transparence. Il souligne aussi que nous sommes ici sur un lieu de synergie internationale, avec le CERN, le CIS, les institutions internationales sur Genève. Il est important de développer des démarches de concertation collectivités et société civile, partenaires publics et partenaires privés… Enfin, il souligne le rôle des femmes dans le développement de l’agriculture familiale.
 Jean Ziegler, le trublion de service
Jean Ziegler, le trublion de service
Avec énergie et conviction, ils nous a enjoint à refuser cet ordre qu’il qualifie de cannibale, à mener un combat politique, en particulier en Afrique qu’il connaît bien.
Le capital financier produit une effroyable misère qui frappe près de 4 Milliards de personnes. 500 personnes possèdent près de 52% des richesses mondiales. Il s’agit là de violence structurelle qui échappe à tout contrôle et justice (que ce soit les états ou les forces syndicales). La pyramide des « martyrs » croit alors que les profits grimpent. C’est un enfant qui meurt de faim toutes les 5 secondes. Il s’agit là pour lui d’un crime organisé à grande échelle.
Le problème majeur est celui de l’accès à la nourriture, car il y a de quoi nourrir la planète.
Que se passe t-il en Afrique ?
Alors qu’il y a croissance du PIB pour certains pays, de par les richesses du sous-sol, il y a donc une vitalité sociale pour certains ; pour les plus pauvres, la faim progresse et l’agriculture familiale est menacée du fait de l’achat de terres
Pourtant, c’est grâce à cette dernière que s’accumulent des savoirs. Le FMI et la BEI y sont pour quelque chose qui font pression sur les états pour le remboursement de la dette. C’est ainsi que des terres sont confiées à des groupes financiers et des multinationales, des contrats de location sur 99 ans. Des paysans sont expulsés, on importe des travailleurs migrants à bas coût.
Les investissements pour accroître la productivité coûtent cher(machines tracteurs, intrants chimiques…).
De plus s’organise une spéculation boursière autour du coût des matières premières (maïs, blé, riz…) Il faut importer avec un coût de transport.
Nous devons donc susciter des prises de conscience pour briser cet ordre inhumain et cannibale, faire respecter les conventions du Droit des paysans (ex des semences), dénoncer les achats de terres opérées par Bolloré. La France devrait s’opposer avec plus de clarté lors des votes. Or, elle a parfois une attitude ambiguë, faisant preuve d’impuissance, cédant aux lobbies.
Les territoires au cœur du développement : du local au global
Pour cette première table ronde, la question était de définir la place des acteurs de terrain pour assurer une transformation durable pour les peuples concernés.
Céline Molinier du PNUD (Programme des Nations-Unies pour le développement) a observé quelques avancées contrariées, hélas, par de nombreuses lacunes. Il n’y a pas d’élaboration collective participative suffisante, même s’il y a quelques efforts à l’échelle de quelques territoires en Afrique.
Quel pourrait être le rôle des collectivités territoriales pour la mise en œuvre effective de mécanismes volontaires et de responsabilisation ? Quelle belle et récurrente question car il revient toujours aux ONG de rappeler aux états leurs obligations !
Mamadou Cissokho, président du réseau des organisations paysannes de l’Afrique de l’Ouest, se demande comment permettre aux paysans de jouer un rôle réel dans le débat international : « La responsabilité des Occidentaux et des Africains est énorme. L’OMC n’est pas notre affaire. Mais, que cherche l’Occident ? A coups d’ajustements structurels du FMI/Banque Mondiale, qui en temps de crise soutient l’exportation des produits occidentaux. La productivité n’est plus un problème depuis les Accords de Cotonou. Il est demandé d’ouvrir les marchés à 80%, on veut donner des leçons, alors que les Africains doivent sur leurs terres trouver les moyens de se nourrir. On assiste à un accaparement de terres. La force de ce continent ce sont les produits alimentaires. C’est notre seule bombe !
Mais les leaders ne veulent pas et obéissent aux ordres appuyés par l’Europe. Il n’est qu’à constater les crises qui se déroulent en Grèce, Espagne et Portugal pour en être conscients. Face à cette situation, comment agir sur les terroirs ? C’est là qu’on « apprend sa vie », où se construisent des savoirs, où l’on imagine l’avenir. C’est un lieu de créations de richesses et de produits d’origine. Il faut donc réfléchir à la faisabilité de l’aide et en réunir les conditions.
De l’Afrique à Coulaines, il n’y a qu’un pas. Celui de la solidarité.
Christophe Rouillon fort d’une double expérience, celle de maire d’un village pauvre et celle de membre de comité des régions de l’Europe, s’interroge sur les questions de coopération avec ses concitoyens, en particulier que la question des services publics de l’eau : « Il y a nécessité de s’éloigner d’une vision coloniale, pour favoriser l’émergence des Droits de l’Homme et de la démocratie, et enfin des services publics. L’émancipation des femmes constitue un levier de développement, c’est ce qui a été constaté par cette coopération avec un village du Niger. Il est important de savoir qui fait quoi et comment afin de mutualiser les forces, de faire circuler les informations (par exemple grâce à l’Atlas de la Coopération). Agir local, penser global et faire circuler la parole, créer de l’humain, nous avons des choses à apprendre de l’Autre, en s’appuyant sur des valeurs humanistes. Cela éviterait bien des drames de l’émigration et du terrorisme. »
Benoit Silve, de Bioforce France, cultive la solidarité au quotidien. Animateur d’un institut implanté dans la banlieue lyonnaise, il développe un travail local de mutualisation des expériences » Cela permet de s’approprier et de renforcer les compétences sur des projets pérennes sur des champs variés : la santé, la nutrition, l’hygiène, l’eau. Ces retours et partages d’expériences constituent des actions de renforcement opérationnel où l’on met la personne en capacité d’agir.
Au centre de tout, se trouve le marché.
Henri Rouillé d’Orfeuil, de l’Académie d’Agriculture de France est convaincu que depuis longtemps l’agriculture s’est construite en rupture avec les territoires : « Au niveau national, on est dans une logique de marché. Le territoire est une matrice de développement économique et de richesses. S’opère de plus en plus un jeu de dynamisme entre la mondialisation et le dynamisme territorial. On a besoin d’arbitrage surtout en période de crise. »
Gérard Pérrissin Fabert, conseiller régional Rhône-Alpes, membre de la Commission Europe, dénonce le millefeuille territorial qui freine la dynamique économique : « La situation actuelle nous incite à fédérer les collectivités locales, pour assurer un meilleur service et coopération. Il ne devrait pas y avoir de champs contradictoires entre le public et le privé, avec une économie la plus inclusive possible. Sachons opérer une démarche économique de partenariat et casser les frontières. »
On a jamais autant entendu parler d’innovations pour reconquérir les marchés, mais que faire quand on n’a pas d’argent pour assurer les services publics ?
Ainsi, l’humanité se trouve piégée par les lois du marché dont les financiers et les lobbies tirent les ficelles.
Coopération solidaire et régionale : quelle source d’innovation pour le développement ?
Au cours de cette deuxième, table ronde, Samira Baghdadi, conseillère municipale, à la Tripoli estime que la situation de cette région du Liban, est particulièrement difficile du fait de l’afflux de réfugiés de Syrie (100 000). Compte-tenu de l’organisation politique du pays ; il y a peu de moyens de décentralisation. Tripoli compte 400 000 habitants, c’est une ville pauvre.(50% vivent sous le seuil de pauvreté). Une coopération s’est établie avec la région Rhône-Alpes, en direction des personnes en situation de rue. Pour qu’elles puissent vivre plus dignement, des projets de formation ont été mis en place dans le champ du bâtiment pour permettre aussi l’insertion sociale, acquérir des compétences, accéder au marché du travail. Il faut renforcer les capacités libanaises et apprendre à cheminer ensemble, d’égal à égal.
 L’agriculture familiale pour que toute la population mondiale puisse manger à sa faim.
L’agriculture familiale pour que toute la population mondiale puisse manger à sa faim.
Face à la montée et à la volatilité des prix alimentaires dans les filières de production, que faire pour créer des perspectives, apporter de la transparence, construire des choix ?
Frédéric Apollin, d’Agronomes et Vétérinaires sans frontières considère que développer les filières courtes est une nécessité pour être moins dépendants sur le territoire, avec des productions locales de qualité que doivent soutenir les collectivités locales : « mais, il faut mener les démarches avec prudence car cette politique n’est pas adaptable partout. Il s’agit de construire de la coopération solidaire avec les Rhône-alpins.
C’est grâce à cette coopération, que les services ont été maintenus au Nord Mali, en cette période de crise, au plus près de la population et de leur bétail.
Bénédicte Hermelin de « coordination SUD- France » insiste pour que cette coopération animée par les élus s’organise avec tous les acteurs, syndicats, acteurs économiques paysans, les commerciaux, les transformateurs, les commerçants…
Ainsi se tisse un ensemble de réseaux qui devra être soutenu dans la durée sur le territoire.
Des ateliers pour vérifier si la coopération solidaire, à l’initiative des collectivités territoriales, répond bien aux enjeux sociaux et économiques des territoires.
François Albert Amichia de l’Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA), encourage la création de liens, de la base au sommet, maires, Régions, conseils de collectifs, mais aussi au-delà des frontières, car en Afrique, celles-ci sont des zones de pauvreté et de conflits
Fatou Ndoye, coordinatrice du pôle agroalimentaire au Sénégal éprouve des difficultés pour établir des connections avec la producteurs : « il nous faut parvenir à consommer ce que nous produisons. Les politiques n’ont pas de lien avec les acteurs, surtout les femmes. Indispensable que les populations soient conscientisées, à la fois sur le plan local et national. »
C’est l’avis de Mustapha Belharca, conseiller régional à la région de Rabat au Maroc : « il nous faut lier le consommateur et le producteur dans un projet agro-écologique par une approche participative. »
S’il est un pays où les expériences d’économie solidaires ont fait florès c’est bien le Brésil. Debora de Lima Nunes Sales, de l’Université de Salvador au Brésil, incite pour que l’économie sociale et solidaire soit un incubateur de pratiques : « il est nécessaire de former les étudiant(e)s qui permettront aux coopératives de construire des stratégies. La question centrale est celle de l’autogestion* Les instances de formation le plus souvent conduisent à la compétition ; la coopération doit se vivre dans la classe et là où les personnes montrent leurs talents. Ainsi pourront se construire des réseaux de ce qui marche (par ex : expérimentation, développement local et touristique, accompagnement, par le biais de l’agriculture). »
Des responsables de réseaux régionaux de formation (RESACOOP)° et de développement économique souligneront combien il est important de voir ce qui se passe ailleurs, tant dans le secteur public que privé.
 La situation de la Palestine, occupée illégalement par l’état israélien, est une des plus dramatiques sur le plan international, tant sur le plan de la répression exercée par l’armée israélienne, que par l’impossibilité des paysans palestiniens de récupérer leurs terres, comme l’explique Issa Elshatleh, responsable d’un centre de développement agricole en Palestine.
La situation de la Palestine, occupée illégalement par l’état israélien, est une des plus dramatiques sur le plan international, tant sur le plan de la répression exercée par l’armée israélienne, que par l’impossibilité des paysans palestiniens de récupérer leurs terres, comme l’explique Issa Elshatleh, responsable d’un centre de développement agricole en Palestine.
Outre la secteur agricole, l’économie touristique est fortement sinistrée dans les zones contrôlées par l’armée israélienne ou le long du mur.
Qu’est-ce qui bloque le dialogue avec la société civile ?
Le conseiller régional Alain Coulombel est très critique sur les capacités des institutions à établir le lien démocratique avec les citoyens : « ils veulent connaître le sens politique de nos actions pour améliorer leur vie. Interrogeons-nous : quels sont les outils servant à mutualiser et créer de l’emploi, dans une démarche participative, dans un respect des marchés publics ? »
Les « grands témoins », Oumou Sall Seck, Maire de Goudam, Mali et le philosophe Pascal Viveret apporteront leurs réflexions sur le contenu des assises
 Oumou Sall Seck, insistera sur la notion d’interdépendance et de solidarité. Comment concilier développement et solidarité alors que surgissent de graves conflits comme au Nord/Mali ? La Région Rhône-Alpes a joué un rôle important lors de la crise au Mali.
Oumou Sall Seck, insistera sur la notion d’interdépendance et de solidarité. Comment concilier développement et solidarité alors que surgissent de graves conflits comme au Nord/Mali ? La Région Rhône-Alpes a joué un rôle important lors de la crise au Mali.
Quel est le rôle de la France dans tout cela ?
Il est important de préserver l’agriculture familiale qui constitue une sécurité humaine et sanitaire. Mais les acteurs auront-ils la force de résister dans le temps, avec la fragilité des frontières, encourageant l’insécurité, les terroristes.
 Pascal Viveret, dressera un tableau plus réconfortant, porteur d’espoir : « Appuyons sur les pratiques de l’Amérique latine : « le Buen Vivir », pour construire des initiatives. Comme le disait Spinoza, face aux paqsiuons tristes, il faut organiser l’énergie de la joie. »(…) « C’est en se fondant sur l’énergie de la joie de vivre que nous pouvons avancer vers une résistance créative à ce système de domination »
Pascal Viveret, dressera un tableau plus réconfortant, porteur d’espoir : « Appuyons sur les pratiques de l’Amérique latine : « le Buen Vivir », pour construire des initiatives. Comme le disait Spinoza, face aux paqsiuons tristes, il faut organiser l’énergie de la joie. »(…) « C’est en se fondant sur l’énergie de la joie de vivre que nous pouvons avancer vers une résistance créative à ce système de domination »
* une question au cœur des trois journées de « Dialogues en humanité » qui se déroulent à Lyon les 4, 5 et 6 juillet.